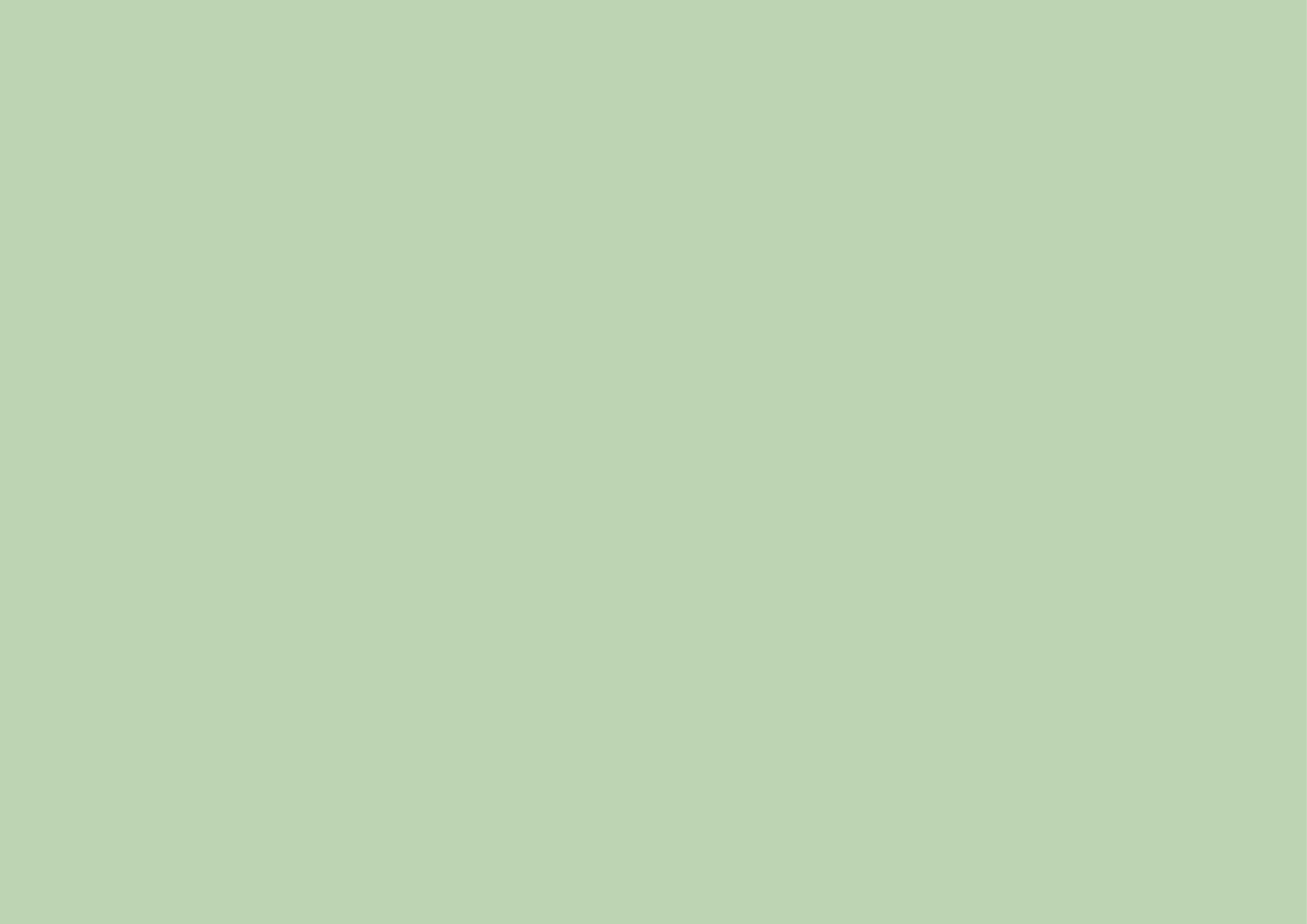
Temps 2 :
Co-construction & recherche
Paysage
Atelier n°2 : Nature & Environnement
Comment inscrire la vie des Miquelonnais au sein de l’environnement ?
Le second atelier concernait le cadre environnemental du projet. S’il y a déplacement, c’est dans une zone naturelle, dans un environnement hostile aux contraintes climatiques fortes. Nous voulions dans cet atelier développer une réflexion sur les potentialités d’utiliser ou de transformer des éléments naturels hostiles à l’habitat des humains, en un process, justement, favorable à une installation durable dans l’environnement.
Il est également abordé la question des sols du village actuel, une fois le déplacement effectué : que faisons-nous des sols abandonnés ?
L’atelier s’est articulé de la même manière que le premier : entre hypothèses territoriales et jeu programmatique. La partie pratique de l’atelier avait pour objectif, cette fois-ci, de choisir et prioriser les éléments naturels potentiels à exploiter dans le nouveau village et la manière dont ils seraient utilisés.
Atelier
SommaireSynthèses
MarianneDes participants du premier atelier sont revenus pour le second. La participation est un peu plus grande, toujours avec une moyenne d’âge assez élevée des participants.
Dès la première hypothèse concernant le positionnement du village, l’envie de proposition se fait entendre : “il nous faut un peu des deux : un peu de A avec un peu de B”. Ils émettent également tout de suite des préoccupations par rapport au vent : se mettre dans les hauteurs signifie être exposé.
Ainsi, une autre précaution est suggérée : “ne pas construire plus que telle altitude (à déterminer et voir “réglementée”).
La conservation de la zone naturelle est évoquée, il est nécessaire d’être à proximité avec la route.
Le village est menacé, mais ne peut pas reculer comme pourraient faire les habitants des littoraux continentaux, un déplacement latéral par le sud-est indispensable.
La question de la protection, vis-à-vis de l’érosion, du village est discutée : Ce serait possible de vivre, dans le village, des décennies ? On parle aussi de l’action du PAPI. En tout cas, l’avis est net : il faut prioriser la protection du village et de ses habitants, car pour l’instant les efforts se font sur la villégiature et le “grand territoire” pour le paysage. Denis Detcheverry, élu à la mairie, a stipulé que plusieurs manières de limiter l’érosion ont été expérimentées sur le territoire, mais n’ont pas donné suite ce qui est dommageable.
La tolérance face à l’eau est presque réduite à zéro. Il est évoqué que subir une inondation est un évènement traumatisant, problématique. Savoir que cela peut se produire régulièrement, crée aussi un certain stresse notamment par mauvais temps. Les habitants proposent tous les 10 ans maximum.
Le vent est l’élément climatique le premier à prendre en compte. Le froid vis-à-vis du réchauffement climatique, et l’eau ne sont plus considérés des problèmes vu notre parti-pris. On nous a témoigné que le vent est de plus en plus fort : à l’époque 40 nœuds, c’était exceptionnel alors que maintenant c’est le quotidien.
Les sols abandonnés doivent être tournés vers l’agriculture, “c’est sûr”. Les discussions s’orientent alors vers le port, existera-t-il toujours ? La réponse a tendance à être oui ! Le port serait le moyen de faire une connexion entre le cap et le sud du pont.
“C’est un mélange des trois” : cette citation confirme la tendance à vouloir diversifier les postures pour ainsi qu’elle devienne subtile et singulière.
Quentin10 personnes présentes, peu de jeunes, mais de nouveaux visages.
L’atelier est une réussite, avec une grande participation et des débats nourris. Nous noterons que cette fois-ci nous n’avons pas de mise au point à faire sur le mot déplacement.
Un bémol s’est fait ressentir concernant un participant qui était mal entendant et qui ne parvenait pas à bien comprendre l’ensemble des éléments présenté, ce qui l’a beaucoup frustré, malgré que nous retirions notre masque afin que celui-ci puisse lire sur nos lèvres.
Cet atelier a montré l’importance du dispositif d’ajout d’hypothèses au questionnaire. Deux principaux changements :
Dans le cas de la question de l’adaptabilité au à la submersion. (Ajout de la proposition décennale)
Dans le cas de la dimension des terrains, trop peu précise. (Atelier 01)
C’est différents changements qui ont fait leurs preuves durant la séance de synthèse avec un vote en large majorité pour ces propositions.
La question des limites urbaines a été abordée, avec l’idée de définir des zones à ne pas urbaniser, pour des raisons écologiques, de risques ou pour une biodiversité (exemple du sud du chapeau)
La compréhension des espaces qui vont disparaitre, telle que la “dune du chapeau” que nous avons déjà pu repérer comme un espace qui sera rapidement touché par l’élévation du niveau de la mer.
La protection de l’existant, des habitants, semble être un des éléments les plus importants pour la population.
Un habitant, a pu également partager son expérience pour nous faire savoir que l’arrivée de l’eau sur son terrain, qui est déjà arrivé et que la maison a été adaptée face aux contraintes représente un stress. Et celui-ci s’est plaint de ne pas avoir été prévenu lors de la construction de la maison, alors même que tout le monde autour de cette table semblait dire que c’était une évidence.
Nous avons également pu parler de la nappe, celle-ci est proche, très proche, un des habitants a pu mettre en avant que lors d’un manque d’eau des habitants, ils avaient réalisé un pompage de la nappe, qui avait provoqué un affaissement de terrain.
La discussion s’est terminée, sur les tourbières et leur exploitation, un habitant qui s’était déjà intéressé au sujet, exprimé le fait qu’elle est trop acide et trop jeune pour être exploitée.
L’atelier fonctionne encore une fois très bien, et permet à la population de donner une échelle aux sols, aux édifices, et d’exprimer leurs priorités.
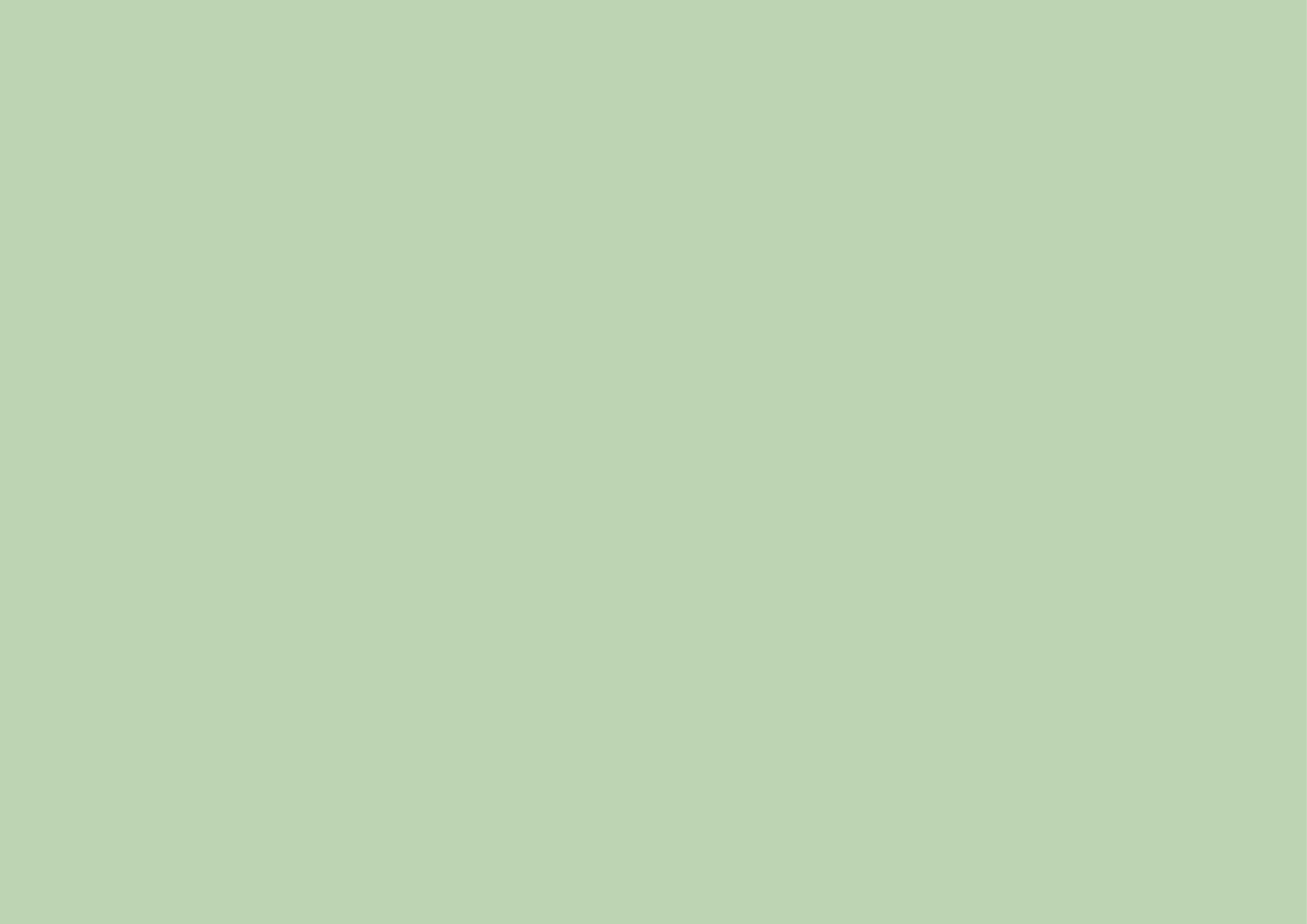
Atelier
ConclusionC’est l’atelier qui a rassemblé le plus de participants. Le résultat est aussi positif que le premier atelier. L’adaptation à un public spécifique est encore à développer/à améliorer/ à prendre plus en compte (présence d’un participant en situation de handicap).
La conscience écologique est présente de manière globale. Une évolution du fonctionnement urbanistique du village est acceptée et envisagée par les participants. Les échanges d’expériences se sont multipliés lors de cet atelier.
Le devenir de Miquelon semble tourné vers la production. Les sols doivent être exploités, les infrastructures lourdes de mobilité conservées au maximum. Un premier plan de zonage ressort de ces deux premiers ateliers.



